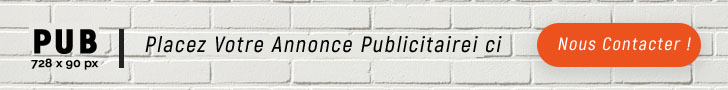Liberté d’expression. La presse Camerounaise face au rouleau compresseur gouvernemental


Analyse sur la situation de la Liberté de la Presse au Cameroun en 2025.
Le Cameroun se classe à la 131ème place sur 180 pays dans le classement Mondial de la Liberté de la Presse 2025. Malgré un paysage médiatique riche en nombre de titres, le pays est considéré comme l’un des plus dangereux d’Afrique pour les journalistes, qui évoluent dans un environnement hostile et précaire. L’enlèvement et l’assassinat du journaliste de renom Martinez Zogo début 2023, l‘arrestation et la condamnation du journaliste Amadou Vamoulké, en témoignent tragiquement.
Paysage Médiatique
Le Cameroun compte un nombre impressionnant de médias (plus de 600 journaux, environ 200 radios et plus de 60 chaînes de télévision). Parmi les titres emblématiques figurent les quotidiens privés Le Messager, Le Jour et La Nouvelle Expression, l’œil du Sahel, l’hebdomadaire privé La Voix du Centre et le quotidien public Cameroon Tribune. Les radios et télévisions privées sont nombreuses, avec Équinoxe (radio et TV), Balafon (radio et TV), Canal 2 International (TV), Radio Tiemeni Siantou et Royal FM parmi les plus connues et Galaxie Tv. La radiotélévision publique CRTV reste un média d’État au service du régime de Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans. Cependant, la production d’une information indépendante et critique demeure un défi majeur pour les journalistes.
Contexte Politique
Adopter une ligne éditoriale critique et indépendante expose les médias à d’importantes menaces et pressions dès que les intérêts du pouvoir sont en jeu. La domination du chef de l’État sur toutes les instances favorise l’autocensure et l’alignement de la plupart des médias sur les positions des autorités administratives. Le président nomme par décret les responsables des médias gouvernementaux et les membres du Conseil national de la communication (CNC), l’organe de régulation. Un exemple récent est l’interdiction ministérielle de tout débat médiatique sur la santé du président de la République, Paul Biya, âgé de 93 ans, à seulement quelques mois de l’élection présidentielle, prévue en octobre 2025.
Cadre Légal
Les lois, y compris celle de 1990 sur la liberté de la presse, sont souvent contournées au profit de la répression du journalisme. La dépénalisation des délits de presse n’est pas effective, et l’accès à l’information ainsi que la protection des sources ne sont pas garantis dans la pratique. Des journalistes sont fréquemment traduits devant des tribunaux d’exception, comme l’illustre la condamnation à 32 ans de prison de l’ancien directeur général de la CRTV, Amadou Vamoulké, sur des accusations jugées sans fondement après un nombre record de renvois.
Contexte Économique
La précarité extrême dans laquelle travaillent de nombreux journalistes camerounais, en particulier ceux des médias privés, nuit considérablement à leur indépendance. L’aide à la presse existe, mais son montant dérisoire et sa distribution semble dépendre de l’alignement des médias sur le régime. Des acteurs proches du pouvoir créent des médias pour affaiblir économiquement les titres critiques. La corruption et le favoritisme sont courants.
Contexte Socioculturel
La multiplication des médias fondés sur des critères ethniques ou religieux contribue à la polarisation du débat public et encourage des prises de position excluantes ou stigmatisantes. Les contraintes culturelles favorisent la censure et l’autocensure, notamment dans les zones marquées par les traditions. La couverture de la crise anglophone, un conflit armé depuis 2017, est particulièrement risquée pour les journalistes, qui peuvent être accusés de « sécession et complicité de bande armée » pour des publications critiques.
Sécurité
Le danger est permanent pour les journalistes critiques ou indépendants, qui sont régulièrement exposés à des attaques verbales et physiques, des arrestations et détentions arbitraires, des procédures-bâillons, des enlèvements et des risques d’assassinat. L’assassinat d’Anye Nde Nsoh, chef du bureau de l’hebdomadaire The Advocate à Bamenda en mai 2023, et celui de Martinez Zogo en janvier 2023, dont l’enquête est toujours en cours, illustrent cette insécurité. De nombreux journalistes connus font l’objet d’une surveillance, et l’impunité pour les auteurs de violence contre les journalistes reste élevée.
Peter Kum