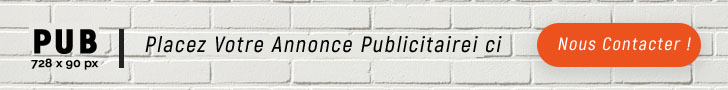Grand-Nord : L’heure des choix

Le Grand-Nord camerounais, entre quête du pouvoir et défis d’un système
« Le développement des régions septentrionales est en suspens depuis 43 ans. La seule assurance, la seule garantie que nous ne serons plus oubliés, c’est, je pense, le retour d’un Nordiste au pouvoir après Paul Biya. » Cette déclaration de Guibai Gatama, figure médiatique et porte-voix du mouvement « 10 millions de Nordistes », résume l’état d’esprit qui agite le Grand-Nord camerounais à l’approche de l’élection présidentielle de 2025. Une région longtemps reléguée au rôle d’électeur-influenceur, mais qui, aujourd’hui, se rêve prétendante au trône. Dans un Cameroun post-Paul Biya – dont l’ère s’étend depuis 1982 –, cette ambition suscite autant d’espoirs que de questions sur l’avenir du pays.
Le poids démographique, une arme à double tranchant
Avec près de 30 % de la population nationale, le Grand-Nord (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua) a toujours été un réservoir de voix pour les régimes en place. En 2018, l’Extrême-Nord a offert à Paul Biya un score record de 89,6 %, malgré des infrastructures scolaires délabrées, des centres de santé sous-équipés et un taux de pauvreté frôlant les 65 % – le plus élevé du pays selon le PNUD. Cette frustration, couplée à un sentiment d’exploitation politique, alimente une revendication de plus en plus présente dans les esprits : si le Nord fait les présidents, pourquoi ne serait-il pas président ? Un calcul simple, mais risqué, dans un système où l’hyper-présidentialisme concentre les pouvoirs à Étoudi. Car derrière l’unité affichée se cachent des fractures profondes. Et si les lamidos, ces chefs traditionnels omnipotents, mobilisent les votes, la jeunesse urbaine, connectée et critique, réclame une nouvelle génération de leaders.
Pourquoi maintenant ? La conjoncture d’une tempête parfaite
Trois facteurs expliquent cette montée en puissance.
D’abord, l’usure du régime Biya, dont l’âge (91 ans) et l’absence de successeur désigné ouvrent une brèche inédite. Ensuite, l’urgence sécuritaire : l’Extrême-Nord, épicentre des attaques de Boko Haram, se sent abandonné par Yaoundé. Enfin, la concurrence régionale : le Grand Sud, fief de Biya, et le Grand Ouest, berceau de l’opposant Maurice Kamto, préparent déjà leurs pions. Le Nord craint de passer à côté de l’alternance.
Mais au-delà des calculs électoraux, c’est tout un système qui est remis en cause. « Au Cameroun, le président est le seul maître du budget et des nominations. Sans lui, un ministre nordiste ne peut même pas asphalter une rue », analyse un diplomate européen. Cette logique explique pourquoi les élites du Nord, ainsi que la nouvelle génération montante, estiment que seule la présidence permettrait de lancer un Plan Marshall pour la région.
Prendre le pouvoir ou le partager
La voie royale serait de présenter un candidat nordiste unifié. Mais si la présidentielle leur échappe, le Nord pourrait, de par son poids politique, exiger un gouvernement de compensation : des ministères clés (Économie, Défense) et un Premier ministre issu de ses rangs, tout au moins. Cependant, l’histoire montre que ces postes sont souvent symboliques. Sous Biya, plusieurs Nordistes ont occupé des portefeuilles stratégiques, sans impact tangible sur le terrain.
Reste la carte d’une véritable décentralisation et d’une certaine autonomie. Le Nord pourrait revendiquer la gestion de ses ressources et la création de régions spéciales dotées de budgets autonomes. Une réforme qui requerrait un consensus national, improbable sans pression populaire.
Peut-on réformer le système sans le briser ?
Derrière la quête du pouvoir se pose une question existentielle : un président nordiste peut-il réformer un système taillé pour une élite ? Paul Biya lui-même, originaire du Sud, a reproduit les déséquilibres hérités d’Ahidjo, un Nordiste. Le problème n’est donc pas ethnique, mais systémique. Sans une refonte des institutions – limitation des mandats, indépendance de la justice –, même un fils du Nord serait captif des réseaux clientélistes.
Dans un Cameroun épuisé par différentes crises et inégalités, l’enjeu dépasse le Nord : il s’agit de prouver que l’alternance est possible sans chaos.
Djafsia Tara MAMOUDOU, Ingénieur des mines
et de la géologie