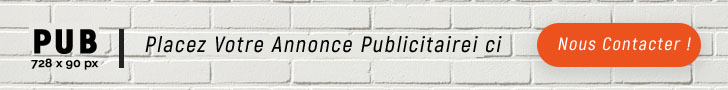GRAND NORD : ET SI C’ÉTAIT L’UN D’EUX L’ÉLU ?
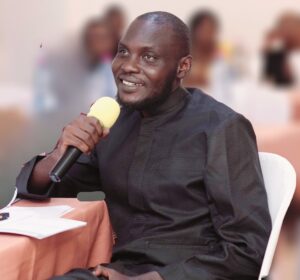
Dans un contexte politique marqué par la soif croissante de transformation sociale et économique, et surtout par la quête de »l’oiseau rare » capable d’emmener un vent nouveau, le Grand‑Nord est face à une interrogation à l’approche de la présidentielle de 2025 : Quel est le profil idéal du candidat pour le Grand-Nord ?
Nous avons voulu, dans cette chronique, prendre le risque pas du tout aisé de dresser le portrait-robot du candidat nordiste. Dans cet exercice, deux visions majeures du leadership régional émergent comme les plus aptes : d’un côté, le candidat politique, artisan de la continuité institutionnelle ; de l’autre, le candidat révolutionnaire, porteur d’une rupture radicale avec les pratiques établies. Mais pour aller au-delà nous avons envisagé une troisième figure : le candidat diasporique, pont entre l’intérieur et l’extérieur, porteur d’un imaginaire renouvelé.
I. Le candidat politique
Ce potentiel candidat s’inscrit dans une trajectoire classique, un serviteur de l’Etat ou qui s’y est longtemps frotté. Il tire sa légitimité d’un long parcours avec ou au sein des institutions, une bonne maîtrise des procédures administratives, une connaissance de la négociation budgétaire et des rouages permettant que les salaires soient payés à temps. Cette dernière est une qualité dont peut se targuer le président Biya. Il sait établir des alliances, tant au niveau national qu’avec les autorités traditionnelles. Son discours est celui de la stabilité, du réalisme et de la prudence. Il proposera un programme structuré : réhabilitation de routes, désenclavement, modernisation des plateaux techniques hospitaliers, ouverture de centres de formation professionnelle dans les chefs-lieux départementaux…
Sa première force réside dans sa capacité à rassurer les institutions et les bailleurs de fonds. Sa familiarité avec l’appareil étatique lui permet de garantir un certain niveau de financement des grands projets. Il sait de mobiliser les instruments de planification, faire valider des projets concrets, respecter les échéanciers. En consolidant ses alliances, il maintient les régions dans une trajectoire de stabilité.
Cette proximité avec le système devient aussi une faiblesse. Il est perçu comme un produit du statu quo, incapable de répondre à l’urgence sociale et à la soif de changement, surtout chez les jeunes. En incarnant un pouvoir vertical et centralisé, il peut rater les nouvelles aspirations citoyennes. Son langage prudent, son refus de prendre des risques, et son attachement aux figures traditionnelles peuvent lui aliéner une partie de l’électorat.
II. Le candidat révolutionnaire
Ce profil émerge des luttes locales, des frustrations accumulées, des campagnes citoyennes, elle est spontanée et née de la mobilisation numérique. Il construit sa légitimité sur une volonté farouche de rupture complète avec l’ancien système. Il propose une décentralisation effective, une création d’emplois en milliers, développements basé sur le domaine agricole. Son style est direct, sa parole brute et ses idées disruptives.
Sa capacité à faire rêver et mobiliser est sa grande force. Il transforme les colères en espoirs, suscite un sursaut d’adhésion militante jusque dans les zones rurales. Il incarne l’avenir pour une jeunesse désabusée, avec un discours qui redonne confiance. Il promeut la redevabilité, l’autonomie locale et une nouvelle éthique politique.
Mais ce profil est fragile. Le risque de messianisme est réel : porté par une frange exaltée, il peut être perçu comme un « sauveur ». Son absence de relais dans les administrations freine l’exécution de ses idées. Il affronte une forte résistance des élites installées. Son discours radical inquiète partenaires et bailleurs. Il devra aussi encadrer ses partisans pour éviter les débordements, une compétence encore peu maîtrisée chez les nouveaux leaders politiques connectés.
III. Le candidat diasporique
Le candidat diasporique est une figure montante. Il a vécu ou étudié à l’étranger, dans les grandes capitales africaines, européennes ou nord-américaines. Il revient avec un regard neuf sur le Cameroun et une volonté d’agir pour sa région d’origine. Ce profil tire sa légitimité d’une double identité : enraciné culturellement, mais façonné par des expériences extérieures. Il se veut moderne, technocrate, avec une vision inclusive de la gouvernance, souvent influencée par les modèles de démocratie participative ou de gestion publique efficiente vécues ailleurs.
Le principal atout de ce profil est sa capacité à faire le pont entre deux mondes. Il maîtrise les nouvelles technologies, les dynamiques internationales, les financements innovants, et dispose souvent de réseaux puissants dans la diaspora et les ONG. Son discours, articulé, fondé sur la transparence et l’efficacité, plaît à une jeunesse éduquée et à une classe moyenne émergente. Il introduit de nouveaux standards de gouvernance : planification stratégique, évaluation de performance, innovations sociales.
Sa distance prolongée du terrain peut jouer contre lui. Il peut être vu comme un « étranger », peu au fait des réalités locales, avec un langage parfois déconnecté. Son retour peut être mal accueilli par les élites en place qui y voient une menace. Il manque souvent de base militante et d’ancrage communautaire. Son ambition peut aussi être perçue comme carriériste, sans attachement réel au sort des populations.
IV. Ce que veut la jeunesse du Grand-Nord
Avant de trancher sur le profil idéal du candidat, il est impératif d’écouter la jeunesse du Grand-Nord, qui constitue la majorité démographique mais reste marginalisée politiquement et économiquement.
Ce que cette jeunesse demande est clair : un accès digne à l’éducation, à l’emploi, à la formation professionnelle et à la santé. Elle aspire à une société où la naissance ne détermine pas le destin, où les talents locaux sont valorisés, et où la méritocratie supplante les réseaux clientélistes.
Elle veut rompre avec la résignation et exige une gouvernance de proximité, des leaders accessibles, capables de répondre aux besoins urgents : désenclavement des zones rurales, accompagnement agricole, inclusion numérique, lutte contre la consommation de drogues, et surtout, espace d’expression libre et protégée.
Cette jeunesse, consciente et connectée, ne se contente plus de promesses. Elle réclame des résultats mesurables, des indicateurs de progrès, et une redevabilité sans compromission. Elle ne veut plus être une variable d’ajustement dans les calculs politiques, mais l’actrice principale de son destin.