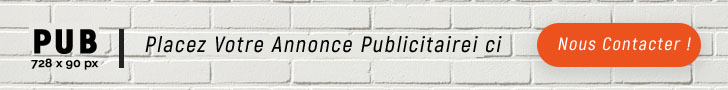Chronique de Djafsia Tara Mamoudou: Présidentielle 2025 L’UNDP à l’heure des grandes décisions

L’Adamaoua gronde, le Grand Nord observe, Yaoundé retient son souffle.
Le 28 juin 2025, le Palais des Congrès de Yaoundé accueillera une réunion décisive du Comité central de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP), convoquée par son président national Bello Bouba Maïgari. Cette rencontre suscite à la fois espoirs, interrogations et prudence. Cette rencontre, élargie exceptionnellement aux membres du Conseil national et aux secrétariats des organes annexes, pourrait sceller la fin de l’alliance historique entre l’UNDP et le RDPC, vieille de plus de deux décennies.
À l’approche de l’élection présidentielle d’octobre 2025, une nouvelle dynamique semble émerger au sein de L’UNDP. Le « old party » du Grand Nord pourrait rompre avec son allié de longue date et de ce fait reprendre son indépendance. Mais cette inflexion ne tombe pas du ciel. Elle serait la conséquence d’un profond grondement venu de la base, notamment dans l’Adamaoua, bastion incontesté de l’UNDP, où la frustration militante s’est muée en revendication assumée :celle de redevenir une force politique indépendante.
- UNDP-RDPC : une alliance historique aux contours ambigus
Depuis 1997, l’UNDP fait partie du gouvernement, dans le cadre d’une plate-forme d’alliance avec le RDPC. Cette alliance, nouée au lendemain de tensions politiques post-électorales, visait à stabiliser les institutions et à favoriser une gouvernance inclusive. Elle a permis à l’UNDP d’occuper des portefeuilles ministériels et de maintenir une visibilité institutionnelle, en particulier dans les régions septentrionales.
Cependant, cette cohabitation prolongée a progressivement dilué l’identité propre du parti. Avec le recul, l’alliance a surtout bénéficié au RDPC. L’UNDP, bien que représentée au gouvernement, a peu pesé sur les grandes décisions nationales. Le parti a perdu progressivement ses députés, ses mairies, ses voix, jusqu’à devenir l’ombre de ce qu’il était. De 68 parlementaires en 1992, il n’en reste que 4 aujourd’hui. Les militants s’interrogent : à quoi bon rester dans une alliance qui leur donne peu de reconnaissance politique et aucune perspective d’influence ?
- L’Adamaoua : Bastion incontesté
Région stratégique s’il en est, l’Adamaoua concentre aujourd’hui l’essentiel de la puissance politique de l’UNDP. Le parti y contrôle le Conseil régional, la mairie de la ville de Ngaoundéré, plusieurs mairies d’arrondissement, et dispose de députés à l’Assemblée nationale. Cette force institutionnelle s’accompagne d’une animation politique vivace, d’un tissu militant bien structuré, et d’une population de plus en plus politisée.
C’est dans cette région que le mécontentement s’est cristallisé, porté par des appels à l’émancipation du RDPC, à une candidature propre, et à la reconquête de l’autonomie partisane. Dans les coulisses, certains cadres de la région n’hésitent plus à évoquer la nécessité d’un « sursaut historique » pour redonner à l’UNDP le rôle moteur qu’il mérite.
III. L’héritage d’Ahidjo et le besoin de sens
Fondé à la croisée des mémoires du Grand Nord, l’UNDP reste le dépositaire symbolique d’une tradition politique héritée du président Ahmadou Ahidjo. C’est cette filiation, plus sentimentale que doctrinale, qui continue de nourrir la loyauté de nombreux militants dans les trois régions septentrionales. Aujourd’hui encore, le parti conserve des élus dans le Nord, l’Extrême-Nord et l’Adamaoua-preuve que cette mémoire, malgré les vents contraires, n’a pas disparu.
Mais cette mémoire ne suffit plus. Elle demande à être incarnée, renouvelée, et transformée en action politique. Car l’histoire, si elle n’est pas portée par une volonté contemporaine, devient un capital dormant. Et dans les interstices de cette attente, certains acteurs politiques, discrets mais stratégiques, commencent à occuper le vide laissé par les anciens géants.
IV-Trois scénarios pour 2025 : rupture, repositionnement ou repli ?
À l’heure de vérité, trois scénarios se dessinent pour l’UNDP :
La rupture franche. Le parti décide de présenter son propre candidat à la présidentielle. Ce choix radical imposerait une refondation idéologique, une remobilisation militante et une reconquête territoriale. Ce serait un pari risqué pour son leader, mais audacieux.
Le repositionnement stratégique. L’UNDP brandit la menace d’une candidature autonome pour négocier un meilleur partage du pouvoir avec le RDPC. C’est le scénario du « ni rupture, ni reddition », un jeu d’équilibriste dangereux mais potentiellement payant.
Le repli tactique. Après des discours d’indépendance, le parti revient dans le giron du RDPC, comme en 2004, 2011 et 2018. Un choix de prudence, mais à haut risque : celui de perdre le peu de crédit politique qui lui reste.
- Silences, frémissements et appétits dissimulés
Dans ce climat de recomposition silencieuse, une réalité s’impose : le paysage politique du Grand-Nord n’est plus figé. Des personnalités publiques, figures politiques aujourd’hui, affûtent leurs réseaux et leurs discours. À défaut d’avoir l’assise électorale de l’UNDP, elles misent sur l’usure du parti pour apparaître comme des alternatives « plus courageuses », « plus clivantes », voire « plus audibles ».
Là, où l’UNDP hésite encore à se libérer, certains se préparent déjà à récupérer le courant soulevé par une éventuelle fronde. Il ne s’agit pas ici de concurrents frontaux, mais de forces latentes, capables de séduire les militants déçus, d’agréger des ambitions orphelines et, pourquoi pas, de se positionner pour 2025 si l’occasion se présente. Si l’UNDP n’assume pas le leadership de ce renouveau, d’autres le feront. Et ceux-là n’auront pas nécessairement la mémoire, la légitimité ou l’enracinement du parti.
- L’heure des choix mesurés
Au-delà des affects militants, des frustrations accumulées ou des appels à la rupture, l’UNDP se trouve aujourd’hui face à une équation éminemment politique complexe : comment exister à nouveau sans se marginaliser ? Comment redonner sens à une identité partielle, fondue dans la majorité présidentielle depuis près de trois décennies ? Et surtout, comment faire évoluer une alliance devenue, avec le temps, source de soupçons et de fatigue, sans tomber dans le piège de l’isolement stratégique ?
Le rendez-vous du 28 juin 2025 s’annonce donc moins comme une scène de confrontation que comme un moment de clarification. Ce sera l’occasion, pour Bello Bouba Maïgari et les cadres du parti, de réévaluer leur positionnement dans un environnement politique en mutation, où la loyauté ne suffit plus à garantir la légitimité.
Entre maintien prudent, repositionnement tactique ou émancipation affirmée, l’UNDP devra choisir non pas en fonction de la seule nostalgie ou des injonctions de la base, mais à la lumière d’un double impératif : rester audible dans le débat public et utile dans l’architecture démocratique. C’est à ce prix qu’il pourra espérer dépasser son statut actuel de survivance politique pour redevenir un acteur d’influence au sein du jeu national.