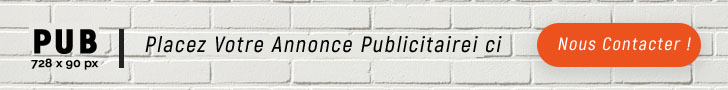Chronique de Djafsia Tara Mamoudou , CAMEROUN : L’URGENCE D’UNE DECRISPATION POLITIQUE

À l’aube des élections présidentielles de 2025, le paysage politique camerounais se trouve plongé dans une tension palpable. La crispation qui règne depuis plusieurs années s’est intensifiée, nourrie par des discours de haine et des invectives tribalistes qui minent la cohésion nationale. Dans un contexte électoral où chaque mot peut avoir des répercussions dévastatrices, il devient urgent d’envisager une décrispation politique – un processus de détente collective et de dialogue ouvert, capable de transformer l’atmosphère conflictuelle en une dynamique constructive.
Le phénomène ne se limite pas aux seules déclarations des responsables politiques. Il se propage à travers des réseaux sociaux enflammés par des militants, dont l’engouement pour une rhétorique incendiaire ne fait qu’exacerber les divisions déjà vives entre communautés. Les discours haineux, souvent teintés de tribalismes, ne servent plus à argumenter sur des programmes ou des idées ; ils deviennent des armes de mobilisation, destinées à créer des camps d’opposition et à diaboliser l’autre. Cette polarisation, qui transforme la diversité en une source de conflit, menace non seulement la stabilité du scrutin à venir, mais aussi l’unité de toute la nation.
Pourtant, la situation actuelle n’est pas irréversible. Il est encore possible de renverser la tendance en engageant une véritable décrispation politique, qui implique une prise de conscience collective et des réformes structurelles. La première étape consiste à reconnaître la responsabilité partagée de tous les acteurs – qu’il s’agisse des politiciens, des militants, des médias ou des citoyens – dans la propagation de ces discours toxiques. Trop souvent, certains leaders se réfugient derrière des positions intransigeantes, exploitant les ressentiments historiques pour renforcer leur base électorale. Or, en adoptant un discours ouvert au dialogue et en prônant le respect mutuel, ils pourraient redonner à la politique son essence même : un espace de débats et d’échanges d’idées pour le bien commun.
Les médias, quant à eux, occupent une position cruciale dans ce processus. Si certains, en quête d’audience, se livrent au sensationnalisme en relayant des messages incendiaires, d’autres se doivent de montrer l’exemple en offrant une information rigoureuse et équilibrée. La responsabilité journalistique, en cette période électorale, est d’autant plus grande que la liberté d’expression ne doit pas se transformer en instrument de division. Des institutions telles que le Conseil National de la Communication doivent continuer d’exiger une éthique irréprochable et d’appliquer les sanctions prévues par la loi pour décourager toute incitation à la haine et à la violence.
Au-delà des discours, le processus de décrispation doit également passer par des réformes concrètes dans l’appareil étatique. La décentralisation, qui a été introduite pour rapprocher les décisions du terrain, doit être pleinement opérationnelle afin que les collectivités locales puissent répondre efficacement aux besoins de leurs citoyens. Un transfert plus important de compétences et de ressources permettrait non seulement de mieux adapter les politiques publiques aux réalités locales, mais également de renforcer la légitimité des acteurs régionaux. Par ailleurs, une meilleure représentation des voix du Grand Nord dans les hautes sphères du pouvoir contribuerait à apaiser les frustrations accumulées et à instaurer un sentiment d’équité dans le partage des richesses nationales.
Il ne faut pas sous-estimer l’importance d’une mobilisation citoyenne active dans ce processus. Les jeunes, qui composent une part croissante de l’électorat et dont l’accès à l’information est facilité par les technologies modernes, ne peuvent plus rester indifférents. Leur engagement est crucial pour exiger une gouvernance transparente et une répartition équitable des ressources. En participant à des dialogues publics, en organisant des forums citoyens et en soutenant des initiatives de fact-checking, ils peuvent contribuer à créer un climat de confiance et à réduire l’impact des discours incendiaires.
La décrispation politique, loin d’être une utopie, représente une nécessité pour que le Cameroun puisse dépasser ses divisions et construire un avenir commun. Il s’agit de transformer la rhétorique de haine en un langage de compromis, de reconnaître que la diversité du pays constitue une richesse et non une menace. Les institutions doivent être mobilisées, les lois appliquées avec rigueur, et chacun doit prendre conscience que la paix sociale et la stabilité électorale reposent sur la capacité collective à transcender les clivages identitaires.
En conclusion, alors que le Cameroun se dirige vers une échéance électorale cruciale en 2025, il est impératif que la crispation politique laisse place à une véritable décrispation. Les discours de haine et le tribalisme, qui depuis trop longtemps alimentent les divisions, n’ont pas leur place dans le débat politique. Il est temps de favoriser le dialogue, de promouvoir une gouvernance décentralisée et d’impliquer activement les citoyens, surtout la jeunesse, dans la construction d’un avenir démocratique et inclusif. Seule une mobilisation collective, où chaque acteur – qu’il soit politique, médiatique ou citoyen-assume sa responsabilité, permettra de garantir des élections pacifiques et de restaurer l’unité nationale dans un Cameroun en quête de renouveau.