Opinion : Le renforcement de la paix au Cameroun


Par Dr Théodore TEMWA, Analyste politique
Si le Cameroun peut encore être appelé à bon escient l’Afrique en miniature, ce n’est plus tant à cause des merveilles de tous les recoins du continent qui s’y trouveraient mais à cause des conflits, des souffrances et autres pratiques liberticides qui y ont élu domicile. Qualifiée autrefois de « havre de paix », la rivière des crevettes est devenue aujourd’hui la rivière des larmes de ceux qui sont victimes des exactions des groupes terroristes, des conflits intercommunautaires, des persécutions politiques, des tracasseries policières, d’expropriation foncière, du chômage organisé par les prévaricateurs de la fortune publique, de l’inflation galopante et inquiétante. Si la paix n’est pas seulement l’absence de guerre, la paix des cimetières telle qu’observée ici n’est pas non plus celle recherchée. Si davantage il convient de distinguer la paix négative de la paix positive, cette distinction vaut particulièrement pour le Cameroun où la misère subjective côtoie la vie chère.
Pourtant, le gouvernement déploie d’énormes efforts pour la sécurité des biens et des personnes, pour l’autosuffisance alimentaire, pour l’entrepreneuriat jeune, etc. mais la situation n’est guère reluisante ; on pourrait même dire qu’elle empire si on en croit les cris des populations accablées. Les experts et les théoriciens ont jusqu’ici proposé une panoplie de solutions qui tardent à produire des résultats, les religieux ont à leur tour élevé des prières œcuméniques au ciel pour une vie libérée du mal-être mais la paix en tant que telle reste précaire. D’où cette énième contribution pour le renforcement de la paix au Cameroun. Et la question que tout le monde se pose est évidemment celle de savoir ce qui manque à l’appel pour que ce pays aux potentialités innombrables prenne enfin son envol vers une vie réellement paisible.
Le Cameroun : havre de paix ou paix des cimetières ?
Le Cameroun est-il réellement un pays de paix comme le scandent inlassablement ses hommes politiques et les masses politisées qui le répètent mécaniquement après eux ? Les arguments en faveur de la paix ne manquent pas mais les conflits et les souffrances sont aussi visibles, indiquant que la paix en tant que justice sociale ou accès aux commodités d’existence n’est pas encore au rendez-vous. D’ailleurs, dans La Stratégie de Relèvement et la Consolidation de la Paix dans les régions du Septentrion et de l’Est du Cameroun 2018 – 2022 (RCP) produite par le gouvernement du Cameroun avec l’appui technique du personnel du Groupe de la Banque mondiale, de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union européenne, nous pouvons lire que ce document a été élaboré « pour une accélération des actions de réduction de la pauvreté, concourant à la paix et, par conséquent, au développement durable, notamment dans le périmètre des régions Septentrionales et de l’Est, touchées par les effets négatifs des crises transfrontalières et sécuritaires […] Le choix de cet outil d’envergure transrégionale témoigne de la volonté de l’État d’améliorer durablement les conditions de vie des populations de l’Extrême-Nord, de l’Est, du Nord et de l’Adamaoua, dont les conséquences de la guerre contre la secte terroriste Boko Haram et celles de la guerre interne en République Centrafricaine ont aggravé considérablement la vulnérabilité, l’insécurité alimentaire, la malnutrition et les épidémies. Le mérite de cette Stratégie RCP est qu’elle constitue une réponse appropriée aux problèmes socio-économiques posés dans ces régions. L’accent mis sur le paradigme de la paix et la traduction des besoins des populations en actes, facilitée par un cadre de redevabilité mutuelle, fait son originalité (p. VIII).
Malheureusement, originalité ne rime pas avec réussite. Encore une stratégie pour rien. C’est dire donc que non seulement la paix n’est pas acquise parce que les populations n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins de première nécessité, mais encore la guerre est présente et pendante.
En ajoutant à cela la crise socio-politique dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le féminicide actuellement à la mode, la criminalité urbaine, l’accaparement des terres et la promiscuité dans les autres régions qui forment le « cœur du pays », il devient difficile de dire que le Cameroun est un pays en paix, si ce n’est pour se donner bonne conscience après l’échec.
En outre, le climat social au Cameroun est quelque peu tendu. Il faut prendre très au sérieux les déclarations des Camerounais qui disent banalement que « le Cameroun est risqué », « je veux voir mes enfants grandir ». Il n’est pas rare de voir ses propos critiques à l’égard du gouvernement transformés en atteinte à la sûreté de l’État ou en apologie du terrorisme. En témoigne l’envoi régulier des civils devant les juridictions militaires. Ce caporalisme traduit la rupture du contrat social. Un État policier n’est pas un État de droit ; cela dénote plutôt d’une méfiance et d’une perte de confiance, deux attitudes contraires à la paix. Autant donc parler d’une paix des cimetières et des bastilles où les populations martyrisées sont sans voix devant le rouleau compresseur de la machine gouvernementale.
Dialogue des sourds et improbable paix des braves
La paix peine à s’établir durablement au Cameroun parce que les gouvernants et les gouvernés ne vibrent pas au même diapason. Voici quelque clichés de ce que nous appelons dialogue des sourds :
Lorsque le peuple dit que la pression fiscale est trop forte, le gouvernement dit que ça n’atteint pas encore la moyenne de l’Afrique centrale ;
Lorsque le peuple crie qu’il n’y a pas de routes, d’eau et d’électricité, le gouvernement se félicite d’avoir construit plus de 446 Km de routes bitumées en 2024, des barrages hydro-électriques, des centrales solaires et des systèmes d’adduction d’eau performants ;
Lorsque les fonctionnaires réclament un meilleur traitement salarial, le gouvernement dit qu’il paye régulièrement les salaires, comme s’il s’agissait du même sujet ;
Lorsque les internautes ironisent que « le Cameroun est un continent » pour indiquer le degré élevé de scandales et de paradoxes qui y ont cours, le gouvernement reprend cette expression malheureuse à son compte pour vanter ses prouesses ;
Lorsque le peuple supplicié pleure qu’il agonise et que l’implosion est imminente, les griots du statuquo inondent les plateaux de télévision pour dire que « le Cameroun est un pays debout » et appellent de fait les laissés-pour-compte à la résilience, arguant au passage qu’après tout, la misère n’est pas une spécificité camerounaise, c’est comme ça dans tous les pays du monde.
Lorsque les Camerounais, exaspérés, manifestent leur ras-le-bol à travers des grèves ou des marches pacifiques, le gouvernement dit qu’ils sont manipulés par des opposants tapis dans l’ombre, en mal de popularité et qui n’ont pour dessein malsain que de salir l’image de notre cher et beau pays.
Il y a donc manifestement incompréhension totale entre les acteurs sociaux au Cameroun. D’où viendrait alors la cohésion sociale tant recherchée et vantée en même temps à grand renfort de publicité politique si chacun campe sur sa position ? C’est ainsi que le Grand Dialogue National de 2019 fut lui-même un dialogue des sourds. Il est vrai, c’est une règle que les gouvernements ne négocient jamais avec les terroristes mais la paix des braves exigent que des concessions soient faites. Autrement, on ne fait que perpétuer la guerre et accroître les souffrances des populations civiles. Si les pourparlers sur les zones en guerre n’ont rien donné ou alors n’ont pas été véritablement engagés et que dans le reste du pays les populations suffoquent, nous pensons que la bonne gouvernance impulsée d’en haut peut être d’un apport capital pour le renforcement de la paix au Cameroun.
La bonne gouvernance comme meilleure solution de renforcement de la paix
La bonne gouvernance est la mère de toutes les solutions aux problèmes sociaux comme son contraire, la mal gouvernance, est la mère tous les vices. Si la recherche et le renforcement de la paix sont une affaire de tous, gouvernants comme gouvernés, il incombe tout d’abord aux détenteurs du pouvoir emprunté au peuple, de prêcher par l’exemple en gérant les affaires publiques de manière transparente et efficace. Tenez par exemple :
-La bonne gouvernance empêche la discrimination et désamorce à l’avance les conflits ethnopolitiques ;
La bonne gouvernance combat véritablement la corruption et les populations ont accès à la redistribution des revenus collectivement engrangés ;
La bonne gouvernance évite le détournement des deniers publics et accroît la réalisation des infrastructures pour le bien des populations ;
La bonne gouvernance consolide l’État de droit et cela rassure les populations et scelle leur attachement aux institutions de la république. Les actes de défiance à l’égard du gouvernement sont souvent le résultat d’une gestion arbitraire du pouvoir.
Ainsi, il suffit que la bonne gouvernance prenne place dans nos institutions et le reste nous sera donné par-dessus le marché. Il s’agit ici de renforcer la paix par l’amélioration des conditions de vie des Camerounais. Toute chose qui passe par la bonne gouvernance. La paix ne doit pas être un slogan politique mais une valeur à cultiver, à pérenniser. En cette année électorale et pour les années à venir, la culture de la paix doit devenir notre modus vivendi. Nul n’ignore l’importance de la paix pour sa vie individuelle et pour la collectivité. En attendant de savoir à qui profite le crime, gardons à l’esprit que l’homme ne découvre la valeur des choses qu’il possède que le jour où il les a perdues.

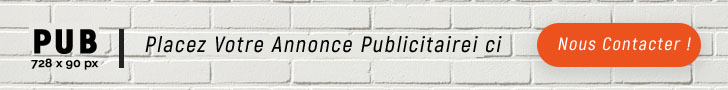






This website, you can find a great variety of online slots from leading developers.
Visitors can try out retro-style games as well as feature-packed games with vivid animation and interactive gameplay.
If you’re just starting out or an experienced player, there’s always a slot to match your mood.
casino games
The games are available round the clock and compatible with PCs and tablets alike.
All games run in your browser, so you can get started without hassle.
Site navigation is user-friendly, making it simple to find your favorite slot.
Register now, and enjoy the thrill of casino games!